|
Les comptabilités analytiques traditionnelles ont essentiellement deux objectifs liés à des préoccupations à court terme dont l'horizon est borné par l'exercice comptable :  | éclater le résultat entre les différents produits, pour détecter ceux qui posent des problèmes de rentabilité (et on a vu les dangers des raisonnements associés à ce type de démarche), |  | répondre à l'obligation légale d'évaluation des stocks sur la base des coûts de production complets. |
L'usage de ces comptabilités analytiques pour le contrôle de la gestion a donné la comptabilité budgétaire, outil peu convivial axé sur la détection d'écarts sur main-d'œuvre et sur matières premières, dont on vient de voir que ce n'étaient plus les paramètres pertinents.
 | Comment élaborer des critères de contrôle qui incitent les responsables à maîtriser les coûts indirects et à réfléchir à leur formation dans le cadre d'une analyse stratégique non bornée par l'horizon de l'exercice ? Comment les inciter à raisonner aussi sur l'impact des choix qu'ils font lors de la conception des produits, sachant que les coûts engagés durant la durée de vie d'un produit sont en fait déjà déterminés à plus de 90% avant même que ne commence la fabrication ?
La solution actuellement développée dans un petit nombre d'entreprises réside dans ce que l'on appelle la comptabilité par activités, souvent appelée dans le jargon anglo-saxon méthode ABC, comme Activity Based Costing 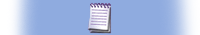 On parle aussi de méthode ABM comme Activity Based Management, pour évoquer l'usage des activités dans un sens plus large de contrôle de gestion "stratégique".  . L'idée est de moins se préoccuper de rattacher les coûts aux produits, même si l'on est encore obligé de le faire pour respecter la contrainte légale d'évaluation des stocks, et de se centrer sur l'analyse des coûts des activités, tout particulièrement celles qui génèrent les coûts indirects.
|  |  |  |
Le schéma théorique du calcul des coûts complets n'en est pas, on l'a déjà dit, vraiment bouleversé, car les activités sont des centres d'analyse au sens où ils ont été définis au début de ce cours. Mais il s'agit d'envisager autrement ces centres :  | attacher un soin tout particulier à leur découpage, qui n'a plus pour objet de permettre une ventilation aisée des coûts, mais qui doit correspondre à la préoccupation de gérer vraiment ces activités ; |  | considérer les charges indirectes comme variables à moyen et à long terme, c'est à dire comme susceptibles d'être réduites, même si elles sont fixes à court terme ; |  | mettre en évidence les véritables facteurs de causalité permettant d'expliquer l'évolution de ces derniers et d'inciter les responsables à agir sur eux. |
 | L'activité L'activité se définit comme un ensemble de tâches attribuées à une personne, à une machine ou à un groupe de personnes ou de machines. Une personne, une machine ou un groupe peut avoir plusieurs activités. Le choix des activités est évidemment fonction des caractéristiques des entreprises. Les critères suivants sont toutefois mis en avant par les promoteurs de la méthode :  | privilégier autant que possible celles où un seul facteur de causalité rend bien compte de ses coûts, |  | privilégier les activités qui consomment une partie significative des coûts, |  | distinguer les activités "créatrices de valeur ajoutée" 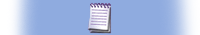 Qui augmentent la valeur des produits pour les clients. L'utilisation qui est faite ici de ce concept n'est pas claire ; il s'agit en fait de faire la chasse aux activités "non productives", c'est-à-dire inutiles. Mais leur détection constitue déjà une grande partie du chemin vers une bonne gestion. Ce critère est donc un peu tautologique.  et celles qui ne le sont pas, dans le but de réduire, voire de faire disparaître ces dernières, |  | en fonction de considérations stratégiques, privilégier les activités qui contribuent à la différenciation du produit et sont exercées de manière originale par rapport aux concurrents. |
|  |  |  |
Au total, chaque activité "coûte" à l'entreprise, selon une logique et un processus temporel qui lui est propre, et c'est l'évolution de chacune de ces activités qui explique celle des charges de l'entreprise, beaucoup plus que le volume de production.
Les coûts des activités sont, à un premier niveau, analysés au travers de "facteurs de causalité" dont le tableau suivant donne des exemples.
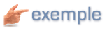 |
| | Activités | Facteurs de causalité | Département achats | Référencement des fournisseurs | Nombre de fournisseurs Nombre de composants | Gestion des appels d'offres | Nombre d'appels d'offres Nombre de fournisseurs consultés Nombre de composants | Passation, suivi et réception des commandes | Nombre de commandes d'achat Nombre de composants | Département commercial | Gestion commerciale | Changements de tarifs Nombre de clients | Prise de commandes | Nombre de clients Nombre de commandes clients Nombre d'appels | Gestion des transporteurs | Nombre de clients livrés Nombre de commandes clients Nombre de transporteurs |
|
|
|  Exemples de facteurs de causalité |
|  |  |  |
|




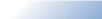


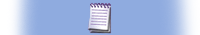





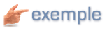
 Exemples de facteurs de causalité
Exemples de facteurs de causalité