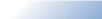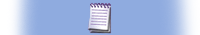|
La moindre importance de la main d'?uvre directe, et l'envolée des charges indirectes
|
|
|
|
On a vu qu'en principe, le modèle de calcul des coûts complets prévoyait un choix très diversifié d'unités d'œuvre pour ventiler les frais des différentes sections. Rien n'empêche donc a priori de choisir les plus pertinentes possibles, c'est-à-dire celles qui expliquent le mieux la variation des charges indirectes. Mais dans la pratique, les entreprises ont pour la plupart pris l'habitude de privilégier l'heure de main d'œuvre directe comme unité d'œuvre unique servant à ventiler sur les produits les frais indirects, assez grossièrement regroupés. On attribue ce choix à l'influence persistante de l'idéologie taylorienne, caractérisée entre autres par un souci constant de minimiser les coûts de main-d'œuvre, souci qui date d'un temps où ces coûts de main-d'œuvre étaient, avec ceux de matières premières, prédominants, et où les productions étaient stables et peu diversifiées. Les entreprises n'ont d'ailleurs aucune difficulté pour connaître la main-d'œuvre directe, car celle-ci a toujours été suivie de manière très fine pour établir les rémunérations. Mais la main-d'œuvre directe ne représente plus souvent dans l'industrie que 10 à 15% des charges, et l'heure de MOD n'est plus l'unité d'œuvre pertinente que pour quelques centres de l'entreprise. Par ailleurs, l'évolution des processus de production fait que les charges variables proportionnellement avec la production se réduisent en fait de plus en plus aux matières consommées, ce qui ôte beaucoup d'intérêt à la méthode du direct costing, où les marges variables deviennent une part prédominante du chiffre d'affaires et sont comparées à des charges trop grossièrement considérées comme fixes, et prédominantes dans l'ensemble des charges, dont on ne sait plus très bien en réalité comment elles varient et à quel horizon, selon les décisions envisagées  . . Les comptabilités analytiques actuelles constituent donc souvent des outils insatisfaisants qui fournissent des informations que les responsables savent peu fiables, mais perdurent à cause de l'inertie des systèmes et des procédures comptables, dont le coût élevé de transformation incite à différer la refonte. L'extension de l'automatisation a toutefois souvent entraîné une retouche du système comptable, facile à opérer, et consistant à remplacer dans les centres de travail l'heure de main-d'œuvre directe par l'heure de machine : l'affectation des temps machines aux produits se fait à partir des nomenclatures de composants et des gammes opératoires, d'autant plus aisément que ces deux outils sont de plus en plus informatisés. Et l'on constate alors un bouleversement de la structure des coûts des produits, par rapport à l'ancien mode de calcul. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à bien rendre compte de la formation des coûts dans l'entreprise, car ce n'est pas forcément le nombre d'heures de machines qui induit les charges indirectes, ces dernières ayant souvent par ailleurs bien d'autres facteurs explicatifs. Certains auteurs ont fait l'hypothèse (et l'ont vérifiée localement) que la formation des coûts indirects s'expliquait bien par les nombres de "transactions" de logistique, d'équilibrage, de réglage, de contrôle de la qualité, de modification du plan de production, etc... Ils proposent alors de retenir comme critère de ventilation des charges indirectes la longueur du cycle de production, le nombre de transactions étant supposé étroitement lié à ce temps. Cette idée, qui renvoie à l'évidence aux modèles de gestion japonais, où l'on cherche à réduire les délais à tous les stades du fonctionnement de l'entreprise, n'est pas simple à mettre en œuvre, à supposer qu'elle soit vraiment fondée : comment mesurer tous les délais de tous les composants ? comment pondérer les délais de ces composants ? ... On va voir que la comptabilité par activité reprend cette idée de tenir compte de l'importance de ces diverses transactions dans la différenciation des coûts, mais de manière plus fine. |