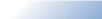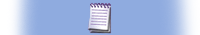|
Introduction ? Des modèles différents pour des usages distincts
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous allons maintenant examiner un troisième modèle de comptabilité d'entreprise, la comptabilité analytique, qui est un instrument à usage interne tourné vers la gestion de sous-ensembles distingués dans l'activité de l'entreprise. Corrélativement, il s'agit aussi très souvent du contrôle a posteriori des responsables chargés de cette gestion. Par rapport à la comptabilité générale, dont elle emprunte les données au départ et avec laquelle elle s'articule, la comptabilité analytique va se distinguer techniquement par le fait qu'au lieu de recenser des charges classées selon la nomenclature des partenaires extérieurs à la firme : four-nisseurs de matière première, banque, prestataires de services, PTT, fisc, etc., c'est-à-dire selon une nomenclature de charges par nature, les charges seront reclassées et ventilées par destination. L'entreprise n'est plus considérée comme une entité uniforme, mais comme un assemblage complexe de moyens, de techniques, de responsabilités. Il ne s'agit plus de savoir si telle charge correspond à une facture payée à tel tiers, mais de déterminer quelle part de cette charge peut être attribuée :
Le Plan Comptable Général définit de la manière suivante l'objet d'une telle analyse :
En résumé, la comptabilité analytique a quatre grands usages distincts : justifier des prix de vente, donner des éléments permettant de décider, fournir des paramètres de contrôle, évaluer des biens et des services. Chacun de ces usages renvoie à des qualités spécifiques  : :
Mais comme on le verra, aucune modalité particulière de calcul de coûts ne permet vraiment de satisfaire à la fois à tous ces impératifs, et si la mesure a été conçue en fonction de l'une des missions ci-dessus, elle sert plus ou moins bien les autres. La mise en oeuvre d'une comptabilité analytique coûte cher, mobilise de nombreuses énergies, implique des saisies spécifiques, donne lieu à tous les niveaux à manipulation de très nombreux documents, imprimés et fiches. Le poids d'un tel système d'information et les habitudes qu'il génère conditionnent durablement le mode de pensée et le comportement de chacun à l'intérieur de la firme. Cette inertie explique la difficulté fréquemment rencontrée lorsque, pour effectuer une étude particulière, on recherche des informations que le système ne fournit pas, n'ayant pas été prévu pour cela  . . Ce cours a pour ambition de donner les définitions usuelles et de décrire les principales méthodes de comptabilité analytique. Dans le chapitre II, nous verrons comment s'organise la comptabilité en coûts complets, système qui est historiquement le plus ancien et le plus répandu, ne serait-ce que parce que la loi en impose le principe pour l'évaluation des stocks et des éléments de patrimoine produits par l'entreprise. Le chapitre III montrera comment les comptables ont tenté de remédier aux inconvénients des coûts complets pour effectuer certains choix, par l'analyse de la variabilité des charges et par la conception de deux méthodes, le "direct costing", et l'imputation rationnelle. Nous évoquerons ensuite dans le chapitre IV les principes qui président à l'élaboration de ce que l'on appelle le contrôle budgétaire (comparaison par rapport à des normes, mesure et explication d'écarts). Nous verrons enfin au chapitre V que les comptabilités analytiques telles qu'elles sont effectivement mises en œuvre dans la plupart des firmes sont en crise, compte tenu des évolutions des techniques et des modes de production. Ce constat ne remettra pas vraiment en cause les principes qui auront été étudiés précédemment, mais indiquera une manière nouvelle de bâtir une comptabilité analytique adaptée à la gestion, et de s'en servir : c'est ce que l'on appelle actuellement la comptabilité par activités. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||